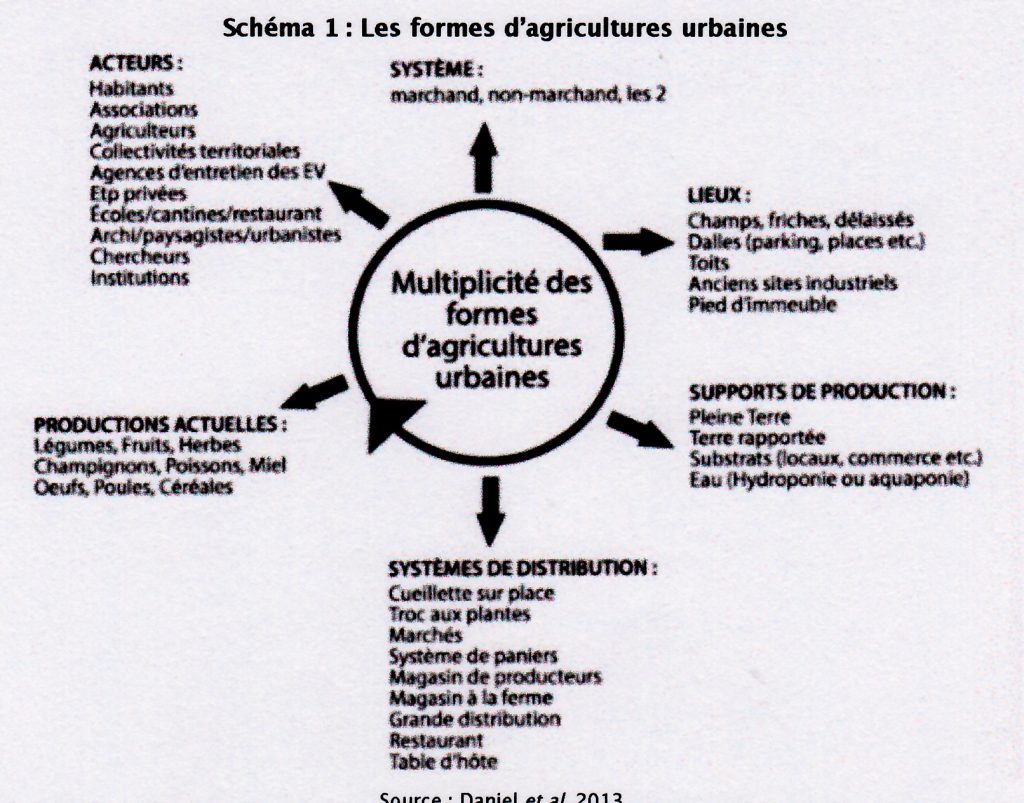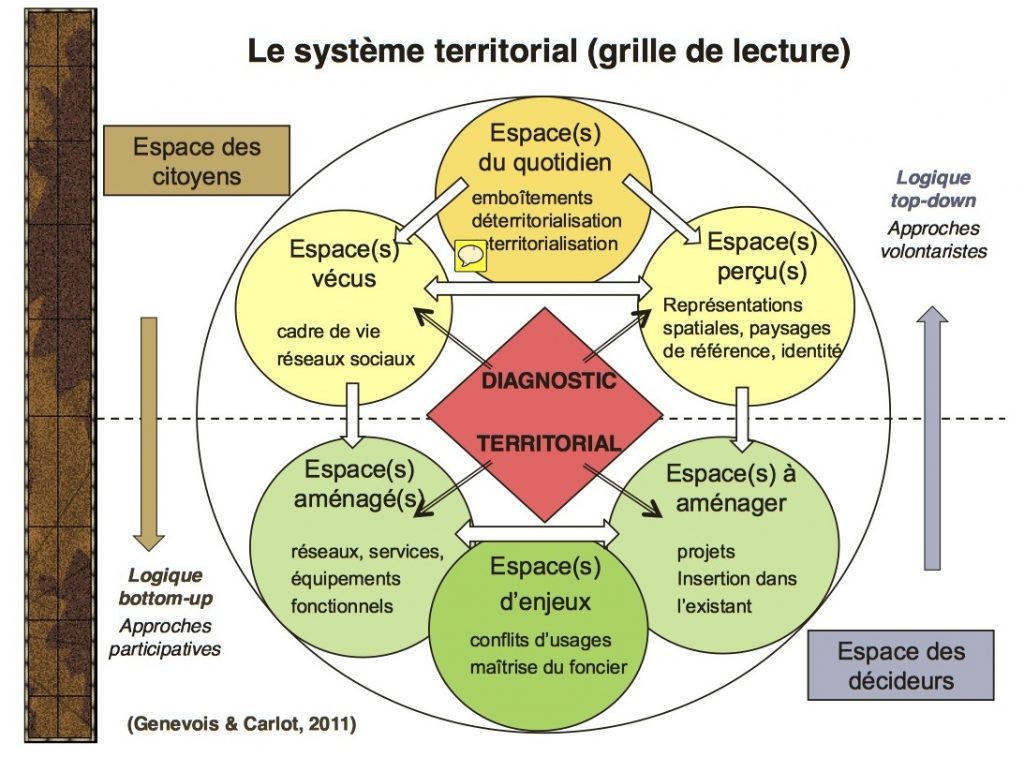Choix d’articles en ligne sur le site http://www.portes-essonne-environnement.fr
Une inondation c’est « l’eau qui monte » soudainement, et d’une façon inattendue. Elle s’impose aux êtres humains en modifiant leur libre activité antérieure. Elle fait entrer ses victimes dans une série d’univers paradoxaux violents qui constituent autant de « passages » :
- celui de la temporalité courte de l’urgence immédiate (vivre pendant) et de la temporalité longue de l’oubli progressif (vivre après),
- celui du discours « tous-les-moyens-sont-mobilisé » et « nous-avons-la-situation en-main » des autorités et la réalité vécue sur le terrain ,
- celui des explications fatalistes (on n’y peut rien) et des polémiques accusatoires (c’est la faute à…),
- celui du reproche implicite fait aux habitants de demeurer dans une zone inondable alors qu’un permis de construire en bonne et due forme leur été délivré,
- celui de l’annonce de « reconnaissance de catastrophe naturelle » et la réalité des versements des assurances.
Autant de sujets d’étude et d’enquête qui ne sauraient se contenter d’une seule approche technique ou administrative, historique ou géographique. Ils nécessitent de mobiliser des moyens d’analyse et d’enquête prenant en compte les acquits des sciences sociales et humaines, notamment ceux de l’anthropologie des catastrophes.
On trouvera ci-dessous un choix d’articles en ligne.

Inondations de la rivière Yvette à Savigny-sur-Orge, rue des Rossays, le 2 juin 2016. © Photographie Bernard Mérigot pour PEE, 2016.
· Orge. Inondations. Enquête publique sur le Plan de prévention des risques d’inondation de l’Orge et de la Sallemouille (PPRI) Les communes situées en aval vont-elles continuées à être inondées par les communes de l’amont de l’Orge ? Il y a urgence à revoir le Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI). Le dossier complet est soumis à enquête publique du lundi 13 mars au vendredi 21 avril 2017. Une enquête annoncée à […] Cette entrée a été publiée dans Enquête publique, Inondations, Intelligence informationnelle, Orge le 7 mars 2017 par Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT.
· Savigny-sur-Orge. Histoire des inondations dans le secteur Kennedy – Rossays. Des études oubliées ! (Partie I) Préambule : Les trois paradoxes de l’histoire des inondations L’histoire des inondations est paradoxale. Pour au moins trois raisons. Le premier paradoxe tient à la temporalité : celle des événements (l’inondation par elle-même), la façon dont elle est vécue localement, et celle de ce qui la suit. Autant son apparition et les parades qui sont […] Cette entrée a été publiée dans Catastrophe naturelle (reconnaissance), Environnement, Épinay-sur-Orge, Histoire des lieux, Histoire locale, Inondations, Morsang-sur-Orge, Orge, Rivières et fleuves, Savigny-sur-Orge, SIAHVY, Syndicat de l’Orge (ex-SIVOA), Urbanisme, Viry-Châtillon, Yvette, et marquée avec Imperméabilisation des sols, Vulnérabilité des lieux, le 4 juillet 2016 par Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT.
· Savigny-sur-Orge. Histoire des inondations dans le secteur Kennedy – Rossays. Des études oubliées ! (Partie II) Suite de la partie I publiée le 4 juillet 2016. III. Des tentatives pour réduire les aléas des inondations, de 1999 à 2008 Le Syndicat, la ville de Savigny-sur-Orge et les 32 autres communes touchées relancent les réunions sur les mesures à prendre. Des réflexions sont menées sur les rehaussements possibles, sur les bassins de […] Cette entrée a été publiée dans Catastrophe naturelle (reconnaissance), Environnement, Histoire des lieux, Histoire locale, Inondations, Orge, Rivières et fleuves, Savigny-sur-Orge, SIAHVY, Syndicat de l’Orge (ex-SIVOA), Urbanisme, Yvette, et marquée avec Imperméabilisation des sols, Vulnérabilité des lieux, le 7 juillet 2016 par Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT.
· Savigny-sur-Orge. Histoire des inondations dans le secteur Kennedy – Rossays. Des études oubliées ! (Partie III) Suite de la partie I publiée le 4 juillet 2016 et de la partie II publiée le 7 juillet 2016. VI. Juin 2016, une nouvelle inondation cinquantennale Le 23 juin 2016, à 17 h 30, le Syndicat de l’Orge a tenu un comité syndical à Brétigny-sur-Orge. Les assemblées générales d’un établissement public de coopération intercommunale […] Cette entrée a été publiée dans Catastrophe naturelle (reconnaissance), Environnement, Histoire des lieux, Histoire locale, Inondations, Orge, Rivières et fleuves, Savigny-sur-Orge, SIAHVY, Syndicat de l’Orge (ex-SIVOA), Urbanisme, Yvette, et marquée avec Imperméabilisation des sols, Vulnérabilité des lieux, le 16 juillet 2016 par Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT.
· Vallée de l’Orge – Savigny-sur-Orge (2). Inondations : des nouvelles du front… comme en 1978 ! Hier, 1er juin 2016, la cote NGF du pont sur l’Orge entre Savigny-sur-Orge était à 36,20 mètre. Aujourd’hui, 2 juin 2016, à 15h35, elle était à 36,80 mètres. L’échelle graduée s’arrête à 38 mètre. Et après… L’Orge passe au-dessus du pont… Le phénomène de débordement de l’Orge le plus significatif est l’inondation de mars 1978 […] Cette entrée a été publiée dans Cadre de vie, Épinay-sur-Orge, Inondations, Orge, Rivières et fleuves, Savigny-sur-Orge, Syndicat de l’Orge (ex-SIVOA), Viry-Châtillon, Yvette le 2 juin 2016 par Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT.
· Vallée de l’Orge, Savigny-sur-Orge (1). Les inondations de début juin 2016 « Y a pas école jeudi. Y a pas école vendredi… », chantent des élèves de l’école primaire Kennedy de Savigny-sur-Orge qui sortent ce mercredi 1er juin 2016 à 11 heures 30. La raison ? L’Orge déborde. Elle a quitté son lit et inonde les quartiers bas de Savigny-sur-Orge, comme ce groupe scolaire situé rue […] Cette entrée a été publiée dans Cadre de vie, Inondations, Orge, Pluies décennales, Savigny-sur-Orge, SIAHVY, Syndicat de l’Orge (ex-SIVOA), Yvette le 2 juin 2016 par Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT.
· Inondations et coulées de boue, 27-28 juillet 2014, Savigny-sur-Orge : état de catastrophe naturelle déclaré Le 3 avril 2015, le site Internet de la ville de Savigny-sur-Orge a annoncé que le préfet de l’Essonne a informé le maire que les intempéries et les fortes précipitations survenues entre le 27 et 28 juillet 2014 ont été reconnues comme relevant de l’état de catastrophe naturelle. (1) Pour les Saviniens qui ont subi […] Cette entrée a été publiée dans Catastrophe naturelle (reconnaissance), Inondations, Intelligence informationnelle, Pluies décennales, Savigny-sur-Orge, et marquée avec Catastrophe naturelle (reconnaissance), Inondations, Intelligence informationnelle, Pluies décennales, Savigny-sur-Orge, le 4 avril 2015
· Orge. Avis défavorable sur le plan de prévention des risques d’inondation de l’Orge et de la Sallemouille Pour les citoyens, les enquêtes publiques sont des moments privilégiés d’accession aux informations publiques qui concernent leur territoire. C’est aussi une occasion pour eux, en tant qu’habitants et usagers d’exprimer leur propre expertise aux élus et aux administrations locales. Ce vendredi 21 avril 2017, Portes de l’Essonne Environnement (PEE) et Culture, Arts Découverte (CAD) ont […]Cette entrée a été publiée dans Enquête publique, Environnement, Inondations, Intelligence informationnelle, Intelligence territoriale, Orge, Rivières et fleuves le 21 avril 2017 par Bernard MÉRIGOT.
· Orge. Plan de prévention des risques d’inondation, le dossier de l’enquête publique Le Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI) de l’Orge et de la Sallemouille est soumis à enquête publique du lundi 13 mars au vendredi 21 avril 2017. (1) Un site Internet dédié a été ouvert à l’occasion. Il est géré par la préfecture de l’Essonne. (2) Comme tous ces sites propres relatifs […] Cette entrée a été publiée dans Enquête publique, Inondations, Intelligence informationnelle, Intelligence territoriale, Orge, Rivières et fleuves le 16 avril 2017 par Marie LAPEIGNE.
· TTME, Epinay-sur-Orge / Morsang-sur-Orge. Et quand le secteur est inondé, que se passe-t-il ? Les habitants du quartier Kennedy – Rossays à Savigny-sur-Orge ont été destinataires, dans leur boîte à lettres, du huitième numéro du Journal tram-train Massy-Évry, deux semaines après les inondations de l’Orge et de l’Yvette qui les ont paralysés en ce début juin 2016 ! Qu’apprend-on dans ce micro-journal dédié ? 1/ Un financement de 84 […] Cette entrée a été publiée dans Inondations, Intelligence opérationnelle, Orge, Savigny-sur-Orge, Tram express sud, Tram-train Massy-Évry (TTME), Transports, Yvette le 30 juin 2016 par Marie LAPEIGNE.
· Crue cinquantennale de juin 2016. État de catastrophe naturelle : 115 communes essonniennes concernées Après avoir déclaré l’état de catastrophe naturelle pour 85 communes de l’Essonne le 8 juin 2016 suite aux inondations vécues en ce début de mois, le Conseil des ministres a intégré dans le classement 30 nouvelles communes lors de la séance du 15 juin. Au-delà des crues des années 1955 (centennale) 1978, 1982, 1983, 1999 […] Cette entrée a été publiée dans Athis-Mons, Catastrophe naturelle (reconnaissance), Inondations, Intelligence informationnelle, Intelligence opérationnelle, Intelligence territoriale, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Orge, Rivières et fleuves, Savigny-sur-Orge, SIAHVY, Syndicat de l’Orge (ex-SIVOA), Viry-Châtillon, Yvette, et marquée avec Cadre de vie, Documents publics, Préfecture de l’Essonne, le 17 juin 2016 par Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT.
LÉGENDES DES PHOTOS
- Inondations de la rivière Yvette à Savigny-sur-Orge, rue des Rossays, le 2 juin 2016. © Photographie Bernard Mérigot pour PEE, 2016.
© Sylvie MÉRIGOT-MONNIOTTE
ISSN 2495-1161. Dépôt légal du numérique, BNF 2017
http://portes-essonne-environnement.fr